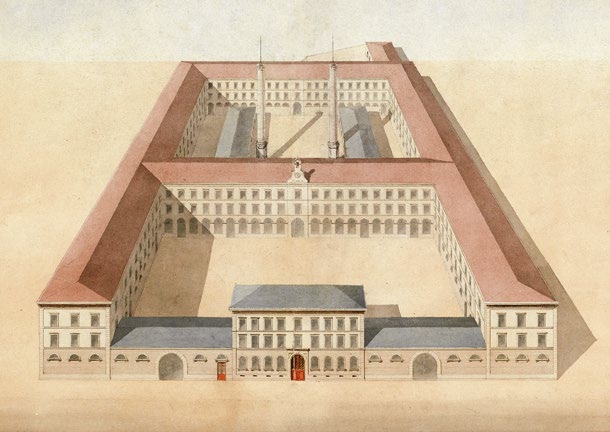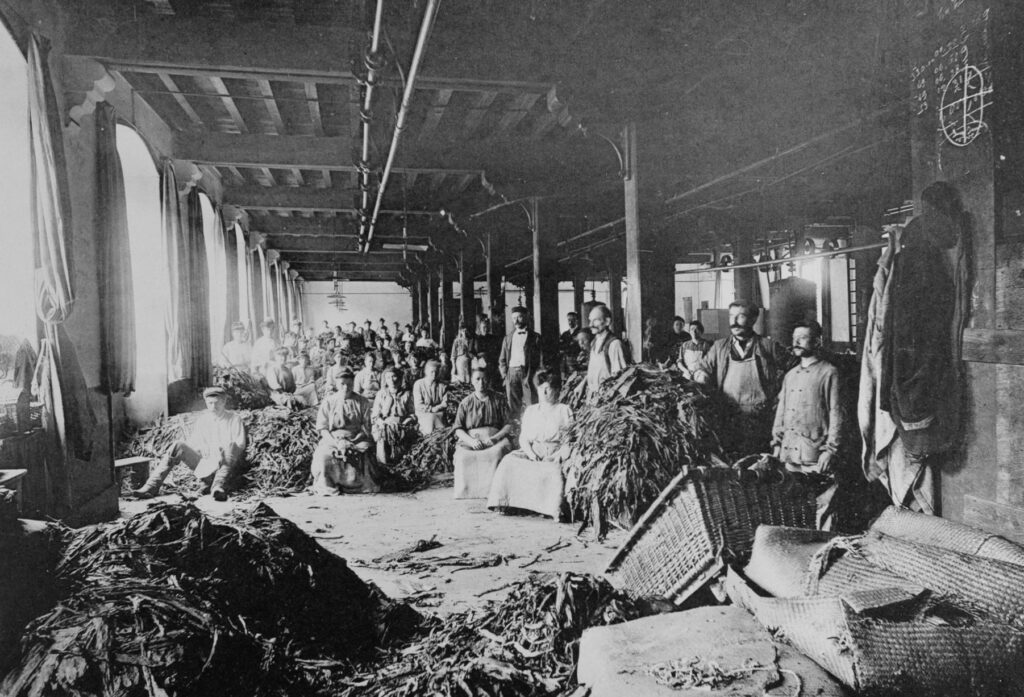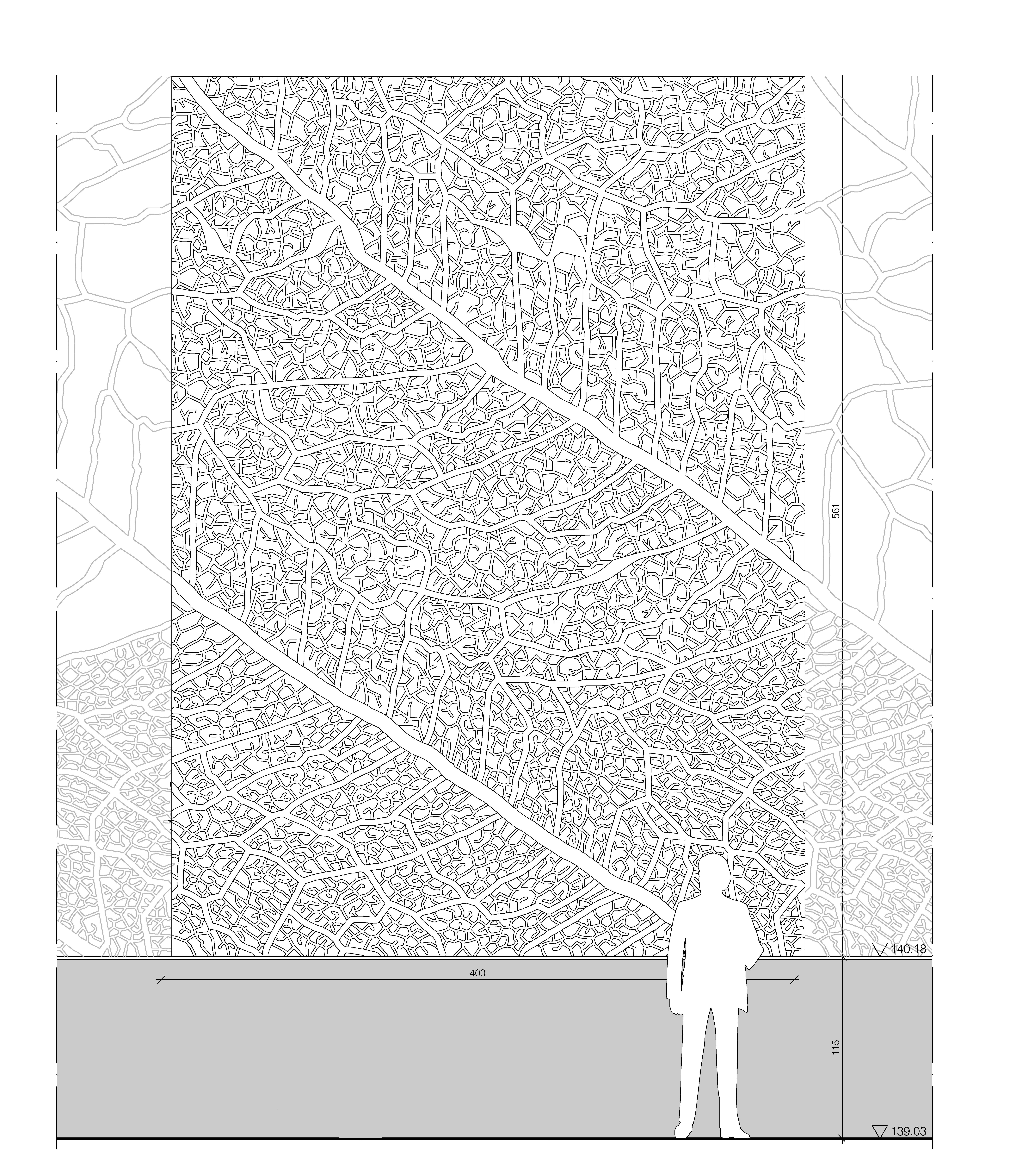Manufacture des Tabacs
Strasbourg (67)
2016 – 2023
Dans le cadre de l’opération campus de l’Université de Strasbourg, le pôle d’excellence Géosciences, Eau, Environnement, Ingénierie (G2EI) a pris place au sein de l’ancienne Manufacture des tabacs, réhabilitée et agrandie. Ce pôle, qui occupe près de 11 000 m², accueille des formations dispensées par deux écoles d’ingénieurs : l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement (Engees) et l’École et observatoire des sciences de la terre (Eost), ainsi que d’autres pôles de recherche liés à ces thématiques. La mutation d’usage est venue s’insérer avec respect et douceur, s’appuyant sur l’organisation naturellement suggérée par les typologies structurelles des espaces existants. La Manufacture, conçue à l’origine à l’échelle des machines et de l’industrie, est aujourd’hui réhabilitée et transformée à l’échelle des étudiants et de la recherche.